Louise, exactement.
- Pourquoi aimes-tu tant les arbres ?
- Je pense que c'est parce qu'ils me font de la peine. Regarde-les par la fenêtre. Ils se font secouer comme des sauvages alors que nous, nous sommes rentrés quand le vent s'est levé.
- Oui c'est vrai.
- Ils sont là, ne bougent jamais d'un millimètre, mais tu vois les feuilles, là, et là, regarde comme elles s'agitent, c'est dingue non ? Tu ne trouves pas ça dingue ?
Elle s'était levée précipitamment, et était venue coller son visage contre la baie vitrée. Avec les paumes en arc de cercle au-dessus des sourcils.
- C'est impressionnant, oui.
- Impressionnant, et toujours ta sale manie de sous-estimer les choses.
Elle parlait contre le verre et de la buée commençait à se former tout autour de sa tête.
- Béatrice a fait les vitres il y a deux heures.
- Béa.
- Qu'est-ce que tu as dit ?
- Rien, je m'étonnais que tu ne l'aies pas appelée Béa.
- Arrête avec tes plaisanteries.
- Ah oui, j'oubliais, c'est proscrit ici.
- Louise ! Cesse ton petit jeu.
- Je ne joue pas, et puis ces arbres sont vraiment dingues, s'ils n'étaient pas si beaux à contempler d'ici, je serais déjà partie.
Elle m'aimait pour ça, pour la vue panoramique de mon bureau, c'était une femme à parenthèses, qui vous laisse rien qu'une petite niche, j'aurais pu me sentir à l'étroit entre deux crochets mais je m'y sentais bien.
Elle était bien plus dingue que les arbres sous la tempête, elle était la tempête elle-même. C'était elle, qui les faisait valser, les branches les feuilles et tous ces machins qu'elle adorait. Et moi aussi, par la même occasion, elle me faisait valser d'insolence, ne laissait aucun mot au fond de ses poches, mais les sortait et me les jetait à la figure sans filet, sans retenue. Je l'admirais. En vérité c'était ça, je l'admirais.
Et elle pouvait bien me traiter de sous-estimeur de choses et complimenter la vue plus que moi-même, j'étais comme un gosse qui rencontre la fille de la nounou.
- Ces arbres sont toujours aussi dingues.
C'était sa phrase, son introduction. Toujours la même en entrant ici. Elle posait son sac sur un des deux fauteuils destinés aux patients et tout en haussant les yeux jusqu'à la baie vitrée :
- Ces arbres sont toujours aussi dingues.
Elle poursuivait souvent par ses phrases d'enfant en expliquant qu'elle aurait dû vivre dans une cabane de lattes de bois et descendre uniquement pour aller s'acheter des sandwichs, qu'elle aurait pu lire toute la journée à vingt mètres du sol et même voir la mer sans avoir à « se taper des centaines de bornes dans une bagnole qui cale ».
La toute première fois, elle était montée pour une partie de cache-cache. Elle était entrée en trombe, sans forcément lire le petit « Sonnez puis entrez » gravé sur la plaque en dessous de la mention d' « Echographiste ». Sans forcément le lire ou en prenant le temps de le lire. Sans vraiment le respecter. J'étais étonné.
Elle était entrée et s'était assise sur un des deux fauteuils. Je m'étais toujours dit qu'il devait y avoir une règle pour ces fauteuils. Une règle que les gens appliqueraient instinctivement. Quelque chose comme, les fous à droite, les autres à gauche, les saints d'esprit, ceux qui sonnent et disent bonjour, les polis, qui ne portent pas leur veste retournée avec la doublure à l'extérieur, par exemple.
Elle s'était affalée sur celui de droite.
- Vous êtes enceinte ?
- Enceinte ? Moi ? Oh non merci ! J'ai déjà assez de mal avec ceux des autres.
- Ceux des autres ?
- Ben oui rendez-vous compte, bientôt une demie heure que je cherche Paco, le petit de la voisine, impossible de mettre la main dessus. Elle va plus tarder, je fais quoi moi maintenant.
- Je n'en sais rien, vous croyez vraiment qu'il est ici ?
- Ici, non ! Mais là, oui !
Elle avait indiqué la fenêtre entrouverte, et plus loin, la forêt. Aux arbres dénudés par l'hiver, on voyait le sol sur des centaines de mètres. Elle était déjà belle. Elle avait les cheveux fins des enfants qui ne font pas attention aux barrettes. Elle était parsemée de tâches de rousseur, un visage à la poudre de cannelle, avec des lèvres toutes fines qui s'agitaient quand elle parlait. Il y avait la naissance de sa poitrine, les minuscules os arrondis qui tressautaient sous le col de sa veste retournée. J'imaginais ses coudes sous le tissu et observais ses mains angoissées se gratter les petites peaux des ongles.
Elle n'était pas belle, elle était gracieuse. Elle avait un corps de clé de sol.
Je la voyais déjà faire de la musique en marchant, des notes fugaces qui s'échapperaient de ses genoux. Pas comme le bruit des gens qui marchent avec leur combinaison de ski, plutôt celui d'une mésange égarée.
- Vous m'aidez ou bien vous préférez continuer à dévisager le fauteuil ?
Et j'étais venu sagement coller mon visage à côté du sien contre la vitre gelée.
- Où est-ce qu'il a bien pu encore aller se fourrer ce minot. Ah j'en étais sure, regardez troisième rangée sur la gauche ! Le manteau bleu sur la grosse branche ! C'est lui.
Elle avait quitté le cabinet presque aussi rapidement qu'elle y était entrée. Sans un au revoir, sans un merci. Après tout je lui avais prêté ma vue, elle s'était contentée d'un petit geste de la main avant de refermer la porte.
Et elle était revenue. Un coup pour chercher Paco, un coup pour Juliette, puis ce fut Faustine et Benoît, à croire qu'elle gardait tous les mômes de la ville. Et un mercredi après-midi, il n'y plus d'enfants. Alors elle me demanda mon prénom.
- Antoine.
- Enchantée, moi c'est Louise.
- Qui avez-vous perdu aujourd'hui ?
- Personne, je suis montée vous dire que je n'ai perdu personne.
- Bien.
Et elle était restée. Elle était restée plus de dix ans dans ce bureau. J'avais dû annuler des régiments de rendez-vous, décaler des armées de femmes enceintes. Elle ne prévenait jamais. Répliquait seulement à chacun de mes reproches:
- Tu sais bien qu'c'est pas mon truc. Et puis prévenir, c'est perdre son temps.
Elle disait ces mots avec un accent de prof de philo, un peu comme si elle avait une patate brûlante dans la bouche. Elle vivait vite et lentement. Entrait vite, sortait vite, m'embrassait lentement, m'aimait longuement.
Je passais mes journées à appliquer du gel froid sur la peau des patients, à déplacer la sonde à ultrasons sur leurs peaux frémissantes, à observer attentivement leurs organes sur l'écran vidéo et à leur tendre du papier pour essuyer le restant de gel.
Et très souvent, entre un abdomen et un pancréas je pouvais apercevoir une veste à doublure retournée, oubliée sur le siège de droite.
On s'aimait comme deux enfants de la forêt, qui se planquent entre les troncs, elle gagnait à chaque partie, j'étais le garçon qui se laisse faire. C'était une couleuvre, un reptile, une iguane, une tricheuse de vie.
Et puis un soir, elle laissa échapper :
- Toi, tu ne vois plus que tes fœtus.
Je voulus crier à l'injustice, crier que les fœtus ne prendraient jamais toute la place. Crier qu'elle était une tornade, qu'elle m'avait rendu aussi perdu que le petit Paco, qu'elle était mille fois merveilleuse comme sa forêt ; mais elle avait poursuivi :
- Mais Antoine, tu ne vois même pas.
- Je ne vois même pas quoi ?
- Tu ne vois même pas que je ne suis plus toute seule.
Et j'étais tombé, d'un coup, de vingt mètres, j'étais venu m'enterrer directement dans le sol, la tête la première, j'avais traversé le plancher, et la chape de béton, elle aurait pu se lever et regarder dans le trou sous ma chaise, elle ne m'aurait même pas aperçu tellement j'avais chuté bas.
Elle s'était décalée de moi, s'était éloignée, avait remis sa veste. Elle n'était plus seule. Non, puisqu'elle était avec moi. Etait-elle seule avec moi ? Je n'avais pas vu, pas vu qu'elle n'était plus seule. Je n'avais surtout rien vu, rien vu venir du tout.
J'annulais des régiments de rendez-vous, décalais des armées de femmes enceintes, pour venir coller mon visage contre la vitre et contempler la forêt. Je la cherchais au détour des troncs, des cimes, je cherchais la couleur de sa veste, ses cheveux, ses tâches de rousseur. Je cherchais sur chacune des branches, entre chacun des arbres, je cherchais Louise à jamais.
Je finis par enlever le fauteuil droit après qu'une troisième patiente s'y soit assise. Je le plaçai à côté du mien, il ne restait qu'un unique siège face à moi, le siège de gauche, celui des saints d'esprit.
Elle n'était plus seule. Elle n'avait sans doute plus besoin de la vue, plus besoin de retrouver des enfants perdus, je l'imaginais aux bras d'un homme qui faisait autre chose de ses journées, qui ne contemplait pas des organes sur un écran vidéo. Je l'imaginais aux bras d'un constructeur de cabanes, un éleveur d'oiseaux, un musicien de genoux, un distributeur de liberté. Sûrement un type qui ne l'enfermait pas derrière une vitre, qui lui faisait découvrir l'immensité pour de vrai. Qui la voyait, pour de vrai. Je ne l'avais pas vu. Je n'avais rien vu du tout.
Et puis je me suis transformé en moutons de poussière, qui s'accumulent, qu'on oublie sous un lit, quand on rechigne à faire le ménage. J'ai rechigné des semaines, puis des mois, des années. Presque cinq ans. Pas même un coup d'aspirateur, j'étais poussiéreux des pieds à la tête, et même à l'intérieur. Poussiéreux de Louise.
Et des hommes l'ont finalement fait pour moi. Des robustes, à coup de tronçonneuses. C'était un mercredi matin, je suis entré, j'ai déposé mes affaires sur mon bureau, et le vide m'a subjugué. Je me suis approché de la fenêtre, et je l'ai ouverte, pour de bon.
En tout premier, ce fut l'odeur qui a manqué, cette même odeur qui reste encore longtemps après que l'on ai jeté le sapin de noël. Devant moi, en contrebas il n'y avait plus rien. Un cimetière, un champ de troncs minusculement minables. Des minis troncs de trente centimètres de haut. Ils avaient tout fait disparaître.
Alors instinctivement, j'ai posé la main sur le téléphone.
Je savais que je ne devais pas y réfléchir plus de dix secondes, j'ai recherché son numéro de téléphone en inscrivant son nom dans la case jaune de la page internet. Elle a mis du temps à charger, j'ai cru qu'elle ne la retrouverait jamais elle non plus. Soudain il y eut son nom, son prénom, son numéro, son adresse, son code postal, d'un bloc.
Je voyais Louise en entière, j'imaginais les balades en âne et les attrape-mouches à la citronnelle, l'été sur la terrasse.
J'ai pris le combiné.
J'ai regardé longuement les numéros en petits pixels, des petits pixels qui allaient faire sonner un téléphone chez une femme à plus de cinquante kilomètres. J'ai relu chaque numéro plusieurs fois pour ne pas risquer d'annoncer la fin d'une forêt à une inconnue.
Et ça a sonné. Une fois, la première, celle où l'on hésite toujours à raccrocher.
J'étais plus immobile qu'un arbre sans vent, droit comme un bouleau, l'air n'entrait ni ne sortait plus de moi. J'étais debout presque sans vie, ma deuxième main pendait contre mon jeans, comme après les prises de sang.
Deux fois, la seconde sonnerie celle où l'on se dit que de toutes façons c'est trop tard quelqu'un est déjà en route pour décrocher de l'autre côté.
A la troisième, j'ai entendu sa voix:
- Allo.
Et bien sûr, ce n'était pas Louise. C'était peut-être Paco, Juliette, Faustine ou alors Benoît, mais pas Louise, c'était une voix d'école maternelle, de jeux de billes, de petit minot. Bien sûr. Bien sûr.
- Est-ce que ta maman est dans les parages ? C'est de la part d'Antoine.
Et j'ai entendu le petit hurler de sa voix aiguë à travers la maison :
- Maman c'est Antoine dans le téléphone, Maman c'est qui le monsieur Antoine ?
Et j'ai entendu la maman, la voix de la gracieuse maman aux genoux musicaux, étouffée par plusieurs mètres de distance, répondre posément, sans se mordiller les petites peaux des ongles :
- C'est ton papa.
Et la forêt m'a soudain paru ridicule. Elle avait raison, je n'avais jamais rien vu, lorsqu'elle avait commencé à ne plus être seule.
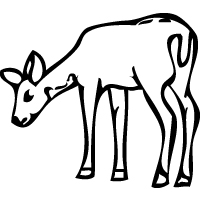
Ouais, juste continue.